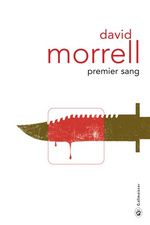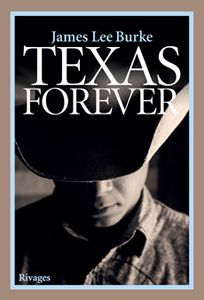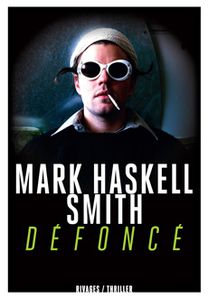Je continue avec mes chroniques en retard. Après une chronique un peu rose, retour de balancier pour un roman très poil aux pattes parfumé à la testostérone. Un roman que j’avais gardé pour l’avion de retour de vacances. Dans ces cas-là, quand on ne peut pas dormir, rien de tel qu’une bonne série B qui cartonne, fait tourner les pages et ne sollicite pas trop des méninges fatiguées. J’avais le bouquin parfait sous la main (c’est que je suis organisé comme garçon). Le 47° samouraï de Stephen Hunter.

Bob Lee Swagger, le sniper, le vétéran du Vietnam à caractère de cochon, fils Earl Lee Swagger autre héros de guerre, ayant participé à cinq débarquements dans différentes iles du Pacifique lors de la seconde guerre mondiale. Au fond de sa retraite de l’Idaho il est contacté par Philip Yano, militaire japonais de son âge : Son père a été tué en 1945 par le père de Bob sur l’île d’Iwo Jima et il est à la recherche du sabre qu’il portait ce jour là.
Bob Lee Swagger retrouve le sabre, et comme il a apprécié son interlocuteur décide de le lui porter en personne. Il ne se doute pas qu’il a entre les mains une pièce mythique qui attire toutes les convoitises et que certain sont prêts à tout pour le récupérer.
Je voulais une bonne série B qui cartonne, j’ai été servi. Si l’on passe sur certains détails de vraisemblance un poil gros, et en particulier sur ce brave Bob Lee qui est certes un guerrier hors du commun, mais qui apprend en une semaine à devenir un champion du maniement du katana … Si donc pour certains détails on accepte de mettre le cerveau en veille, on se régale.
De l’action en veux-tu en voilà, une histoire bien racontée, des scènes de baston toujours aussi efficaces. Une fois de plus Stephen Hunter fait le boulot. C’est ce qu’on lui demande, et c’est très bien comme ça.
Cerise sur le gâteau, j’ai bien aimé la postface où Hunter explique que oui, il s’est renseigné, mais que c’est une œuvre de fiction et que les râleurs de services et autres coupeurs de cheveux en douze (même avec un sabre), peuvent aller … râler ailleurs.
Stephen Hunter / Le 47° samouraï (The 47th samouraï, 2007), Folio/Policier (2013), traduit de l’américain par Guy Abadia.