C’était inévitable. Le choc de La religion m’a donné envie de découvrir les polars de Tim Willocks. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, et j’ai commencé par la fin, tant pis, c’est pas grave, on peut parfaitement lire Les rois écarlates sans avoir lu Bad city blues, même s’il reprend certains personnages.
Lenna Parillaud, richissime propriétaire de Louisiane, ne vit que par la haine et la vengeance depuis près de vingt ans,  depuis que sa fille lui a été enlevée à la naissance. Le psychiatre Cicero Grimes quant à lui se vautre dans une dépression profonde depuis six mois. Les deux reçoivent une lettre de Clarence Jefferson, qui fut leur tortionnaire, et qui va, une fois de plus, changer leur vie et déclencher un ouragan de violence.
depuis que sa fille lui a été enlevée à la naissance. Le psychiatre Cicero Grimes quant à lui se vautre dans une dépression profonde depuis six mois. Les deux reçoivent une lettre de Clarence Jefferson, qui fut leur tortionnaire, et qui va, une fois de plus, changer leur vie et déclencher un ouragan de violence.
Fan de chichourle, voilà un polar qui déménage ! Du violent et sombre comme on n’en lit quand même pas tous les jours. Et pas du préfabriqué, avec serial killer, scènes bien gores pour voyeurisme pépère et flic torturé et borderline monté en kit. Non du qui prend aux tripes et qui dérange. Du qui vous fait regarder la Bête dans les yeux, qui vous plonge dans la Bête que vous avez au fond de vous. Du qui vous fait vous demander si vous aussi, parfois … Avec de vrais personnages, des fous furieux qui font vraiment peur, une bien belle écriture, et une construction en crescendo impeccable.
Et ce n’est pas tout, même si c’est déjà beaucoup. On y trouve aussi, au détour d’une page, quelques interrogations sur ce qu’est l’engagement et le sens de la responsabilité aujourd’hui, par rapport à ce qu’ont vécu des générations antérieures. On y trouve déjà une réflexion sur la pulsion de violence que nous avons tous en nous, une réflexion très présente dans La religion, mais qui est déjà là, en germe. Une réflexion qui nous touche tous.
Qui n’a jamais eu envie de prendre une barrouille (barrouille : gros morceau de bois, fer ou n’importe quoi de dur qu’on a très bien en main et qui fait, toujours, de très gros dégâts) et d’éclater la tronche de … l’Ennemi, quel qu’il soit ? Des millénaires d’éducation et de civilisation font que, habituellement, on ne cède pas, et on se dit que c’est mal. Mais cela n’enlève pas l’envie, et les millénaires ne sont parfois qu’un verni bien fin, si l’on en croit ce qu’on lit et ce qu’on voit autour de nous … C’est aussi cette envie là que Tim Willocks interroge.
Bref, je vais de ce pas acheter Bad city blues.
Tim Willocks / Les rois écarlates, (Bloodstained kings, 1995) Seuil/Points (2009), traduit de l’anglais par Elisabeth Peellaert.



 1565. Soliman le Magnifique, sultan des Turcs, a décidé d'éradiquer un de ses plus féroces ennemis : l'Ordre de Malte, aussi nommé La Religion. Il envoie des dizaines de milliers d'hommes assiéger ces moines soldats fanatiques dans leur propre forteresse. Dans le même temps, un Inquisiteur débarque sur l'île pour tenter de permettre au Pape de reprendre le contrôle de cet ordre, extrêmement riche, et de plus en plus indépendant de Rome. C'est dans ce contexte pour le moins trouble que Matthias Tanhauser, aventurier d'origine hongroise, ayant servi pendant des années dans les troupes d'élite turques avant de s'installer comme trafiquant d'armes en Sicile se laisse convaincre par une belle comtesse de l'aider à récupérer son fils à Malte. Il ne se doute pas qu'il va ainsi mettre les pieds en enfer.
1565. Soliman le Magnifique, sultan des Turcs, a décidé d'éradiquer un de ses plus féroces ennemis : l'Ordre de Malte, aussi nommé La Religion. Il envoie des dizaines de milliers d'hommes assiéger ces moines soldats fanatiques dans leur propre forteresse. Dans le même temps, un Inquisiteur débarque sur l'île pour tenter de permettre au Pape de reprendre le contrôle de cet ordre, extrêmement riche, et de plus en plus indépendant de Rome. C'est dans ce contexte pour le moins trouble que Matthias Tanhauser, aventurier d'origine hongroise, ayant servi pendant des années dans les troupes d'élite turques avant de s'installer comme trafiquant d'armes en Sicile se laisse convaincre par une belle comtesse de l'aider à récupérer son fils à Malte. Il ne se doute pas qu'il va ainsi mettre les pieds en enfer.  Mark Miles est un impresario minable. Magiciens ratés, ventriloques ou tentatives de battre le Guiness des cracheurs de noyaux de cerises sont son quotidien … Quand il réussit à obtenir l’organisation du séminaire du Docteur Temple, gourou sensé transformer en un week-end une bande de gogos en leaders invincibles, il pense avoir décroché le gros lot. Bien entendu, tout ce qu’il va gagner, c’est un paquet d’emmerdes qui mériterait, pour le coup, de le faire entrer lui, dans le Guiness …
Mark Miles est un impresario minable. Magiciens ratés, ventriloques ou tentatives de battre le Guiness des cracheurs de noyaux de cerises sont son quotidien … Quand il réussit à obtenir l’organisation du séminaire du Docteur Temple, gourou sensé transformer en un week-end une bande de gogos en leaders invincibles, il pense avoir décroché le gros lot. Bien entendu, tout ce qu’il va gagner, c’est un paquet d’emmerdes qui mériterait, pour le coup, de le faire entrer lui, dans le Guiness …  Au début de sa saga, Charlie Resnick est inspecteur au CID (Criminal Investigation Department, équivalent de la PJ française) dans la ville de Nottingham. La quarantaine, toujours mal habillé (cravate tachée, chemise qui dépasse du pantalon …), ce grand bonhomme aux yeux sombres, un peu lourd pour sa taille, pas très sportif et souvent fatigué plait pourtant à bon nombre de femmes qui se savent jamais dire d’où vient son charme.
Au début de sa saga, Charlie Resnick est inspecteur au CID (Criminal Investigation Department, équivalent de la PJ française) dans la ville de Nottingham. La quarantaine, toujours mal habillé (cravate tachée, chemise qui dépasse du pantalon …), ce grand bonhomme aux yeux sombres, un peu lourd pour sa taille, pas très sportif et souvent fatigué plait pourtant à bon nombre de femmes qui se savent jamais dire d’où vient son charme.  violeurs, tueurs, bourreaux d’enfants, et excités d’extrême droite racistes et homophobes, mais sait parfaitement qu’il ne résout rien, et que le racisme, la misère, le chômage, la perte de valeurs et de repères de jeunes sans le moindre avenir sont une réalité forgée par des années du gouvernement Thatcher, et jamais démentie par la suite. Il ne peut que constater, désemparé, qu’il ne comprend plus rien aux gens avec qui il vit, même s’il sait bien quelle est la cause première des bouleversements de la société anglaise.
violeurs, tueurs, bourreaux d’enfants, et excités d’extrême droite racistes et homophobes, mais sait parfaitement qu’il ne résout rien, et que le racisme, la misère, le chômage, la perte de valeurs et de repères de jeunes sans le moindre avenir sont une réalité forgée par des années du gouvernement Thatcher, et jamais démentie par la suite. Il ne peut que constater, désemparé, qu’il ne comprend plus rien aux gens avec qui il vit, même s’il sait bien quelle est la cause première des bouleversements de la société anglaise. 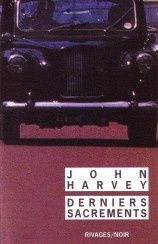 L’interview publié sur bibliosurf, et référencé deux billets plus bas (j’ai la flemme de re-saisir le lien), laisse entendre que l’on va bientôt revoir Charlie. Dire que cette nouvelle me comble de joie est un dous euphémisme.
L’interview publié sur bibliosurf, et référencé deux billets plus bas (j’ai la flemme de re-saisir le lien), laisse entendre que l’on va bientôt revoir Charlie. Dire que cette nouvelle me comble de joie est un dous euphémisme.  Cambridge. Stephen Bryan, jeune professeur homosexuel est retrouvé mort, sauvagement tabassé dans sa salle de bain. Les deux enquêteurs, Will Grayson et Helen Walker, suivent deux pistes : Soit un cambriolage qui a mal tourné, soit un ex amant qui n’a pas accepté la rupture imposée par Stephen. Sur l’insistance de Lesley, la sœur du défunt, il sont également amenés à se poser des questions sur le livre qu’il écrivait avant sa mort : Il s’agissait de la biographie d’une obscure actrice anglaise morte tragiquement bien des années plus tôt. Rien de dérangeant a priori, même si elle était apparentée à un des industriels les plus puissants de la région. A moins que Stephen n’ait découvert de vilains secrets …
Cambridge. Stephen Bryan, jeune professeur homosexuel est retrouvé mort, sauvagement tabassé dans sa salle de bain. Les deux enquêteurs, Will Grayson et Helen Walker, suivent deux pistes : Soit un cambriolage qui a mal tourné, soit un ex amant qui n’a pas accepté la rupture imposée par Stephen. Sur l’insistance de Lesley, la sœur du défunt, il sont également amenés à se poser des questions sur le livre qu’il écrivait avant sa mort : Il s’agissait de la biographie d’une obscure actrice anglaise morte tragiquement bien des années plus tôt. Rien de dérangeant a priori, même si elle était apparentée à un des industriels les plus puissants de la région. A moins que Stephen n’ait découvert de vilains secrets …  Nom de code : Axiom day commence à Londres, à 19h30. Stan Lindow, irlandais, récemment revenu pour prendre un poste à l'Imperial College après une brillante carrière au MIT attend son frère Eammon dans Clarence Street quand le bus qui approchait explose. Aussitôt c'est l'enfer. Stan est blessé et amené à l'hôpital. Au moment de sortir, il est embarqué par deux policiers, et apprend avec stupéfaction qu'il est considéré comme suspect. Interrogé sans relâche, il ne craque pas, mais apprend qu'Eammon qui était dans le bus est très grièvement blessé, et est soupçonné d'être son complice. Le commissaire Foyle, en charge de l'enquête, est presque sûr que les deux frères sont innocents, et après la garde à vue réglementaire, fait libérer Stan. Mais Foyle est aussitôt désavoué par sa hiérarchie, et les services secrets font pression pour le faire évincer. Pourquoi ? Qu'est-ce qui pousse tous ces hauts personnages à insister sur la culpabilité d'un innocent ? Qui protège t'ils ainsi ? Quel secret inavouable ?
Nom de code : Axiom day commence à Londres, à 19h30. Stan Lindow, irlandais, récemment revenu pour prendre un poste à l'Imperial College après une brillante carrière au MIT attend son frère Eammon dans Clarence Street quand le bus qui approchait explose. Aussitôt c'est l'enfer. Stan est blessé et amené à l'hôpital. Au moment de sortir, il est embarqué par deux policiers, et apprend avec stupéfaction qu'il est considéré comme suspect. Interrogé sans relâche, il ne craque pas, mais apprend qu'Eammon qui était dans le bus est très grièvement blessé, et est soupçonné d'être son complice. Le commissaire Foyle, en charge de l'enquête, est presque sûr que les deux frères sont innocents, et après la garde à vue réglementaire, fait libérer Stan. Mais Foyle est aussitôt désavoué par sa hiérarchie, et les services secrets font pression pour le faire évincer. Pourquoi ? Qu'est-ce qui pousse tous ces hauts personnages à insister sur la culpabilité d'un innocent ? Qui protège t'ils ainsi ? Quel secret inavouable ?  conseiller spécial du président des Etats-Unis est assassiné lors de son arrivée à Londres où il devait rencontrer le premier ministre. Au même moment, à l’aéroport d’Heathrow, Isis Herrick, chargée de la filature d’un libraire musulman, remarque un étrange manège parfaitement coordonné, qui conduit à un échange d’identité entre une douzaine de passagers. Immédiatement, une cellule de crise se met en place, craignant que quelque chose de très gros ne se prépare …
conseiller spécial du président des Etats-Unis est assassiné lors de son arrivée à Londres où il devait rencontrer le premier ministre. Au même moment, à l’aéroport d’Heathrow, Isis Herrick, chargée de la filature d’un libraire musulman, remarque un étrange manège parfaitement coordonné, qui conduit à un échange d’identité entre une douzaine de passagers. Immédiatement, une cellule de crise se met en place, craignant que quelque chose de très gros ne se prépare …  Sidonie Keene, vieille dame très digne de 85 ans, est en possession de quelques aquarelles de sa sœur Naomi dont la côte est en train de grimper. Un petit groupe de collectionneurs s'intéressent aux portraits de dignitaires nazis que la jeune peintre avait réalisés entre 36 et 40. A l'époque, elles étaient avec sa sœur très proches du parti d'extrême droite anglais, et avaient voyagé en Allemagne où elles avaient fait connaissance de tout le gratin nazi.
Sidonie Keene, vieille dame très digne de 85 ans, est en possession de quelques aquarelles de sa sœur Naomi dont la côte est en train de grimper. Un petit groupe de collectionneurs s'intéressent aux portraits de dignitaires nazis que la jeune peintre avait réalisés entre 36 et 40. A l'époque, elles étaient avec sa sœur très proches du parti d'extrême droite anglais, et avaient voyagé en Allemagne où elles avaient fait connaissance de tout le gratin nazi. L’inspectrice Sally Birthron, et la Commissaire Principale Adjointe Esther Davidson n’ont pas choisi une mission facile : Elles sont envoyées loin de leur brigade habituelle enquêter sur un éventuel cas de corruption chez les flics locaux. Un de leurs meilleurs indics a été torturé et abattu. Le procès a eu lieu, deux petits malfrats ont été condamnés. Mais le ministère de l’intérieur, sous la pression de la presse, envoie Sally et Esther vérifier si l’indic n’a pas été donné par la police parce qu’il gênait certaines accointances louches en haut lieu. Dire que les deux femmes vont être chaleureusement accueillies et généreusement aidées par les flics locaux serait sans doute un peu exagéré.
L’inspectrice Sally Birthron, et la Commissaire Principale Adjointe Esther Davidson n’ont pas choisi une mission facile : Elles sont envoyées loin de leur brigade habituelle enquêter sur un éventuel cas de corruption chez les flics locaux. Un de leurs meilleurs indics a été torturé et abattu. Le procès a eu lieu, deux petits malfrats ont été condamnés. Mais le ministère de l’intérieur, sous la pression de la presse, envoie Sally et Esther vérifier si l’indic n’a pas été donné par la police parce qu’il gênait certaines accointances louches en haut lieu. Dire que les deux femmes vont être chaleureusement accueillies et généreusement aidées par les flics locaux serait sans doute un peu exagéré.  L'inspecteur Faraday n'est pas à la fête. Il semblerait que sa ville de Portsmouth soit le théâtre d'une guerre de gangs pour le contrôle du trafic d'héroïne. Sa compagne et son fils, qui tournent une vidéo sur les ravages de cette drogue, se retrouvent impliqués dans la mort d'un junkie. Un de ses collègues est laissé pour mort par deux dealers. Pour compléter le tableau, il est recruté pour faire partie d'un groupe très restreint qui mène une guerre secrète, même au sein des forces de police, contre le parrain de la ville. Sur le terrain, c'est la blanche qui gagne.
L'inspecteur Faraday n'est pas à la fête. Il semblerait que sa ville de Portsmouth soit le théâtre d'une guerre de gangs pour le contrôle du trafic d'héroïne. Sa compagne et son fils, qui tournent une vidéo sur les ravages de cette drogue, se retrouvent impliqués dans la mort d'un junkie. Un de ses collègues est laissé pour mort par deux dealers. Pour compléter le tableau, il est recruté pour faire partie d'un groupe très restreint qui mène une guerre secrète, même au sein des forces de police, contre le parrain de la ville. Sur le terrain, c'est la blanche qui gagne.  1939 dans une petite ville de Georgie. Alors que les rumeurs des horreurs en Europe filtrent à peine, la petite ville est secouée par la découverte du cadavre d’une gamine d’une dizaine d’années qui a été violée avant d’être tuée. Joseph Vaughan la connaissait bien, il était en classe avec elle. Quand dans les comtés alentour les viols et les meurtres se multiplient la panique et la colère gagnent. Joseph s’organise avec quatre copains pour patrouiller la nuit, la trouille au ventre. Les adultes eux cherchent un bouc émissaire. Ils finiront bien entendu par le trouver … Quelques années et bien des malheurs plus tard Joseph quittera sa ville pour aller à New York et commencer à écrire. Mais, alors même qu’il pense lui avoir tourné le dos à tout jamais, le passé le rejoindra, de la plus douloureuse façon.
1939 dans une petite ville de Georgie. Alors que les rumeurs des horreurs en Europe filtrent à peine, la petite ville est secouée par la découverte du cadavre d’une gamine d’une dizaine d’années qui a été violée avant d’être tuée. Joseph Vaughan la connaissait bien, il était en classe avec elle. Quand dans les comtés alentour les viols et les meurtres se multiplient la panique et la colère gagnent. Joseph s’organise avec quatre copains pour patrouiller la nuit, la trouille au ventre. Les adultes eux cherchent un bouc émissaire. Ils finiront bien entendu par le trouver … Quelques années et bien des malheurs plus tard Joseph quittera sa ville pour aller à New York et commencer à écrire. Mais, alors même qu’il pense lui avoir tourné le dos à tout jamais, le passé le rejoindra, de la plus douloureuse façon.