William McIlvanney est un fils de mineur (cette information, nous le verrons a son importance), né en 1936 dans une petite ville ouvrière proche de Glasgow. C’est à peu près tout ce qu’il est utile de savoir sur lui, avant d’attaquer ses bouquins.
Les romans de William McIlvanney sont noirs comme la houille, durs et calleux comme les mains des mineurs. A commencer par le magnifique Big Man :
 Thornbank, petite ville sinistrée d'Ecosse. La crise de l'industrie lourde en Europe a transformé une ville ouvrière, avec tout ce que cela sous entend de culture, de luttes, et de solidarités, en une ville perdue, où la notion de classe a disparu avec les plus anciens. Dans ce marasme, quelques légendes locales survivent, et parmi elles, Dan Scoular, Big Man pour tous les habitués du pub, homme entier, chaleureux, capable d'étendre n'importe qui du premier coup de poing.
Thornbank, petite ville sinistrée d'Ecosse. La crise de l'industrie lourde en Europe a transformé une ville ouvrière, avec tout ce que cela sous entend de culture, de luttes, et de solidarités, en une ville perdue, où la notion de classe a disparu avec les plus anciens. Dans ce marasme, quelques légendes locales survivent, et parmi elles, Dan Scoular, Big Man pour tous les habitués du pub, homme entier, chaleureux, capable d'étendre n'importe qui du premier coup de poing.
C'est cette dernière caractéristique qui intéresse Matt Mason, un des chefs de la pègre de Glasgow, qui veut organiser un combat poings nus pour régler un différent avec un de ses concurrents. Dan Scoular, accepte un peu rapidement, pour l'argent, pour ce qu'il représente dans la mythologie virile de ces ex ouvriers rudes et durs au mal, peut-être aussi pour essayer de reconquérir sa femme ... Suivront trois semaines qui l'amèneront à aller au bout de lui-même, physiquement et mentalement. Trois semaines pour s'interroger sur sa vraie nature, sur son image et sur les valeurs auxquelles il a toujours cru.
Le mariage réussi de la boxe et du roman (ou film) noir remonte à la plus haute antiquité (ou presque), déjà les grecs … Mais je m’égare. Rarement le mélange avait atteint une telle densité, une telle richesse et une telle profondeur dans l'analyse et la réflexion. Au premier degré, l'histoire est superbement contée. La tension monte jusqu'à la scène de bravoure que représente le combat, une scène très attendue, qui ne déçoit pas. Et on n’est pas encore au bout de ses surprises.
Mais surtout, tout le roman est une superbe réflexion sur le chemin personnel d'un homme, image de toute une classe qui disparaît. Dan Scoudar, à l’image de toute la classe ouvrière européenne, doit tout reconstruire. Les valeurs qui ont soutenu ses parents, leur attachement à une lutte de classe qui devait amener à des lendemains socialistes qui chantent, se sont effondrés avec le passage des travaillistes (ailleurs socialistes) au pouvoir, et avec la mort de la classe ouvrière organisée. Une classe ouvrière que l’on a fait exploser en opposant ceux qui ont accédé à la classe moyenne (basse), et ceux qui ont raté la marche et sont devenus chômeurs.
Dan ne peut plus calquer son attitude, ses réactions, sur celles de tous ceux qu'il avait respecté jusque là. Il doit réinventer ce qui est juste, redéfinir son camp, ce pour quoi, mais aussi ce contre quoi il doit lutter, pour regagner la liberté et le respect de soi. Tout cela sans décevoir tous ceux qui voient en lui une légende qui les aide à supporter leur propre déchéance. Pour finir, au-delà de ce personnage hors norme, ce qui frappe c'est également la tendresse et l'humanité avec lesquelles McIlvanney décrit tous les supporters de Dan, tous ces perdants pathétiques, pitoyables, mais tellement humains. Un roman bouleversant et plus que jamais indispensable.
A côté de ce roman noir, McIlvanney a écrit trois romans policiers, centrés autour du personnage de Laidlaw, flic  doué et grande gueule de Glasgow. Le premier, Laidlaw, le voit enquêter sur le viol et le meurtre de Jennifer Lawson, 18 ans. Il doit faire vite parce que la pègre de la ville a décidé d'aider le père, colosse rude et violent, à faire justice lui-même. De son côté, un ami du meurtrier cherche à l'aider à quitter la ville sans encombres. Entre ces trois intérêts incompatibles la course est lancée.
doué et grande gueule de Glasgow. Le premier, Laidlaw, le voit enquêter sur le viol et le meurtre de Jennifer Lawson, 18 ans. Il doit faire vite parce que la pègre de la ville a décidé d'aider le père, colosse rude et violent, à faire justice lui-même. De son côté, un ami du meurtrier cherche à l'aider à quitter la ville sans encombres. Entre ces trois intérêts incompatibles la course est lancée.
Outre le suspense créé par une narration adoptant les points de vue des différents groupes lancés à la recherche du meurtrier, ce roman frappe par sa capacité à rendre parfaitement les atmosphères et les émotions. Silence brutal du père, sorte de roc, obtus, aveugle à tout et à tous, plus en colère parce qu'on a osé toucher à sa fille que véritablement peiné ; détresse sans fond de la mère, anéantie par le chagrin, et totalement inexistante, soumise à la violence psychologique du père ; atmosphère d'un Glasgow populaire, délabré mais humain ... Les scènes relatant des situations de tension, d'affrontement psychologique ou physique sont particulièrement impressionnantes. Et puis, ce Laidlaw, cousin écossais du sergent de l'A14 de Robin Cook, pareillement en proie au doute, pareillement torturé, mais également rebelle, indiscipliné, honnête et profondément humain, est un personnage qu'on ne peut qu'aimer, et souhaiter retrouver.
 Dans Etranges Loyautés, Laidlaw en pleine déprime va croiser la silhouette de Big Man. Il a divorcé, sa nouvelle relation bat de l'aile, et son frère Scott de 38 ans vient de mourir, complètement saoul, écrasé à la sortie d'un pub. Jack ne comprend pas pourquoi son frère avait autant changé ces derniers temps, devenant amer, déprimé, et se perdant dans l'alcool. Pour faire le deuil de cette mort, il va mener son enquête, et essayer de comprendre ce qui a bouleversé Scott. Cela l'amènera à remuer un passé qu'il aurait préféré ignorer, mais également à élucider une autre mort, celle de Dan Scoudar, un homme brave, dur au mal et honnête, qui avait défié la pègre de Glasgow, et a fini écrasé par un chauffard que l'on n'a jamais retrouvé.
Dans Etranges Loyautés, Laidlaw en pleine déprime va croiser la silhouette de Big Man. Il a divorcé, sa nouvelle relation bat de l'aile, et son frère Scott de 38 ans vient de mourir, complètement saoul, écrasé à la sortie d'un pub. Jack ne comprend pas pourquoi son frère avait autant changé ces derniers temps, devenant amer, déprimé, et se perdant dans l'alcool. Pour faire le deuil de cette mort, il va mener son enquête, et essayer de comprendre ce qui a bouleversé Scott. Cela l'amènera à remuer un passé qu'il aurait préféré ignorer, mais également à élucider une autre mort, celle de Dan Scoudar, un homme brave, dur au mal et honnête, qui avait défié la pègre de Glasgow, et a fini écrasé par un chauffard que l'on n'a jamais retrouvé.
Ici Laidlaw, ses coups de gueule, et sa recherche sans concession de la vérité croise le fantôme du superbe personnage de Big Man, dernier héros de ce qu'il reste de la classe ouvrière écossaise. McIlvanney complète le portrait d'une société écossaise déboussolée, où ceux qui ont gardé un idéal sombrent dans la déprime face à la puissance et l'arrogance croissantes des parvenus cyniques. Une société où les enfants des ouvriers, dépossédés de tout, même de la solidarité et des valeurs d'une classe sociale qui a disparue en tant qu'entité soudée, se retrouvent finalement dans une situation beaucoup plus désespérée que celle de leurs parents. Laidlaw, sorte de médecin légiste de cette société, incapable de faire abstraction de toutes les ténèbres qui l'attendent au dehors, ne supporte plus l'hypocrisie et l'indifférence de ceux qui ont réussi, et a de plus en plus de mal à maîtriser sa propre violence. Cette vision très sombre de notre monde, est parfois éclairée par de superbes portraits de personnages forts et dignes, souvent des femmes, que McIlvanney peint avec une grande tendresse.
En conclusion, lisez William McIlvanney.
Lailaw (Laidlaw, 1977) Rivages/noir (1987). Traduit de l’anglais (Ecosse) par Freddy Michalski ; Big Man (Big Man, 1985) Rivages/noir (1990). Traduit de l’anglais (Ecosse) par Freddy Michalski ; Etranges Loyautés (Strange Loyalties, 1991) Rivages/noir (1992). Traduit de l’anglais (Ecosse) par Freddy Michalski



 Là où
Là où  Plender était à l'école le souffre douleur, le prolo. Il est maintenant détective privé pourri mais friqué. Son fond de commerce : chantages, adultères … A l’école Knott faisait partie de la même bande, mais lui avait du succès. Il en a toujours ; marié avec une femme qui a de l'argent, il est photographe, et travaille pour des catalogues de sous vêtements. Il en profite pour baiser avec tous modèles qui passent par son studio. Un soir, Plender surprend Knott en train d'essayer de se débarrasser du cadavre d'une jeune femme, morte connement en sortant de son atelier. Il tient alors sa vengeance.
Plender était à l'école le souffre douleur, le prolo. Il est maintenant détective privé pourri mais friqué. Son fond de commerce : chantages, adultères … A l’école Knott faisait partie de la même bande, mais lui avait du succès. Il en a toujours ; marié avec une femme qui a de l'argent, il est photographe, et travaille pour des catalogues de sous vêtements. Il en profite pour baiser avec tous modèles qui passent par son studio. Un soir, Plender surprend Knott en train d'essayer de se débarrasser du cadavre d'une jeune femme, morte connement en sortant de son atelier. Il tient alors sa vengeance.  Crime Unlimited se déroule donc dans les années 60, à Londres. Harry Stark est un personnage aussi charismatique que dangereux. Ceux qui croisent sa route l’apprennent vite, pour leur bonheur ou leur malheur et le racontent. Terry l’amant qui essaya de le doubler ; Lord Thursby, fragilisé par une situation financière catastrophique et une homosexualité cachée ; Jack the Hat, petit truand minable ; Ruby, starlette qui n’eut jamais son heure de gloire ; Lenny, sociologue, criminologue,
Crime Unlimited se déroule donc dans les années 60, à Londres. Harry Stark est un personnage aussi charismatique que dangereux. Ceux qui croisent sa route l’apprennent vite, pour leur bonheur ou leur malheur et le racontent. Terry l’amant qui essaya de le doubler ; Lord Thursby, fragilisé par une situation financière catastrophique et une homosexualité cachée ; Jack the Hat, petit truand minable ; Ruby, starlette qui n’eut jamais son heure de gloire ; Lenny, sociologue, criminologue, deux romans précédents, et boucle la trilogie en mettant en scène trois personnages qui ont été, ou vont être, marqués par un revenant … Harry Stark. Julie est actrice, elle essaie de faire croire qu’elle vient de la bonne société londonienne, mais elle cherche en fait à oublier son père, ancien truand, tué en Espagne dans les années soixante par Harry Stark. Tony est un journaliste véreux, assassin à ses heures, qui rêve s’écrire le De sang froid anglais, mais végète à faire le nègre de différents truands dont les mémoires, plus ou moins bidouillées, s’arrachent. Gaz, petit voyou violent sans envergure ne devraient rien avoir en commun avec les pointures du crime londonien ; il croisera pourtant leur route. A l’enterrement d’une vieille gloire, quelqu’un croit apercevoir Harry …
deux romans précédents, et boucle la trilogie en mettant en scène trois personnages qui ont été, ou vont être, marqués par un revenant … Harry Stark. Julie est actrice, elle essaie de faire croire qu’elle vient de la bonne société londonienne, mais elle cherche en fait à oublier son père, ancien truand, tué en Espagne dans les années soixante par Harry Stark. Tony est un journaliste véreux, assassin à ses heures, qui rêve s’écrire le De sang froid anglais, mais végète à faire le nègre de différents truands dont les mémoires, plus ou moins bidouillées, s’arrachent. Gaz, petit voyou violent sans envergure ne devraient rien avoir en commun avec les pointures du crime londonien ; il croisera pourtant leur route. A l’enterrement d’une vieille gloire, quelqu’un croit apercevoir Harry … 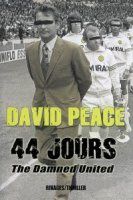 années 60-70 pour apprécier ce roman ? Je crois que, comme le dit
années 60-70 pour apprécier ce roman ? Je crois que, comme le dit  île écossaise. Il mène une vie aussi rangée qu’il peut avec sa femme et son fils. Jusqu’au jour où il est contacté par la police de San Diego : Son frère Jim, journaliste a été retrouvé mort dans sa voiture. Suicide. Gordon part pour organiser les funérailles, mais sur place de nombreux détails clochent. En quelques jours il apprend que son frère enquêtait sur une énorme entreprise chimique, croise un ami de Jim qui est persuadé qu’il a été assassiné, et s’aperçoit qu’il est suivi. Mais surtout, du coin de l’oeil, il aperçoit un fantôme, un homme des SAS qu’il croyait mort lors de sa dernière mission, en Argentine, pendant la guerre des Malouines. Gordon Reeve revient alors sur ses terres, pour préparer la contre-attaque et affronter son passé.
île écossaise. Il mène une vie aussi rangée qu’il peut avec sa femme et son fils. Jusqu’au jour où il est contacté par la police de San Diego : Son frère Jim, journaliste a été retrouvé mort dans sa voiture. Suicide. Gordon part pour organiser les funérailles, mais sur place de nombreux détails clochent. En quelques jours il apprend que son frère enquêtait sur une énorme entreprise chimique, croise un ami de Jim qui est persuadé qu’il a été assassiné, et s’aperçoit qu’il est suivi. Mais surtout, du coin de l’oeil, il aperçoit un fantôme, un homme des SAS qu’il croyait mort lors de sa dernière mission, en Argentine, pendant la guerre des Malouines. Gordon Reeve revient alors sur ses terres, pour préparer la contre-attaque et affronter son passé.  Un designer qui monte qui monte, dont le Tout Londres commence à parler, ça n’a pas envie de se laisser emmerder par un petit bonhomme terne et ennuyeux. Alors quand, un matin aux aurores, Mister Kitchen vient lui prendre la tête sous prétexte de lui acheter sa bagnole, notre designer pète un peu les plombs, et transperce le dit Kitchen avec une de ses créations. Seulement voilà, un emmerdeur mort reste un emmerdeur, dont il faut se débarrasser. Et quand une journée commence mal, il y a peu de chances qu’elle se termine bien. Les choses vont même aller de mal en pis pour notre pauvre artiste, qui va tenter de compenser en s’enfilant dans le gosier et dans le nez toutes sortes de produits, ce qui ne va pas améliorer son calme et sa lucidité. Une vraie journée de merde !
Un designer qui monte qui monte, dont le Tout Londres commence à parler, ça n’a pas envie de se laisser emmerder par un petit bonhomme terne et ennuyeux. Alors quand, un matin aux aurores, Mister Kitchen vient lui prendre la tête sous prétexte de lui acheter sa bagnole, notre designer pète un peu les plombs, et transperce le dit Kitchen avec une de ses créations. Seulement voilà, un emmerdeur mort reste un emmerdeur, dont il faut se débarrasser. Et quand une journée commence mal, il y a peu de chances qu’elle se termine bien. Les choses vont même aller de mal en pis pour notre pauvre artiste, qui va tenter de compenser en s’enfilant dans le gosier et dans le nez toutes sortes de produits, ce qui ne va pas améliorer son calme et sa lucidité. Une vraie journée de merde !  devrait faire date avec l’interview exclusif de Jon Jackson, toute nouvelle coqueluche du cinéma anglais que Diane et Barry connaissent de l’époque où il tournait les clips des groupes rock. A moins d’une semaine de la sortie de la revue, le corps du cinéaste est découvert atrocement torturé, d’une façon qui rappelle une des scènes de son film. La presse conservatrice se rue sur l’occasion pour stigmatiser la mauvaise influence d’un certain cinéma, les groupies se désolent, Neil flaire le scoop, et Diane et Barry tentent de noyer leur chagrin dans le travail. Ils ne savent pas qu’ils vont être happés par cette affaire et y laisser des plumes.
devrait faire date avec l’interview exclusif de Jon Jackson, toute nouvelle coqueluche du cinéma anglais que Diane et Barry connaissent de l’époque où il tournait les clips des groupes rock. A moins d’une semaine de la sortie de la revue, le corps du cinéaste est découvert atrocement torturé, d’une façon qui rappelle une des scènes de son film. La presse conservatrice se rue sur l’occasion pour stigmatiser la mauvaise influence d’un certain cinéma, les groupies se désolent, Neil flaire le scoop, et Diane et Barry tentent de noyer leur chagrin dans le travail. Ils ne savent pas qu’ils vont être happés par cette affaire et y laisser des plumes. 
 Vous le savez peut-être déjà, Royston Blake est anglais. Plus précisément il est de Mangel. Pour autant, Blake n’est pas un gentleman. Loin s’en faut. Blakey comme l’appelle familièrement les habitants de Mangel est Le Videur de la ville. Celui du Hoppers, pub où se réunit le gratin. Il se plait à se considérer comme un notable, quelqu’un à qui l’on doit le respect. Pour un œil extérieur, Blake apparaît comme une masse de 110 kg de barbaque, de bière et de bêtise. Mais comme c’est lui qui raconte … Or, malgré sa notoriété et sa respectabilité, une fois de plus, le pauvre Blake va foncer tête baissée dans les pires emmerdes quand la ville se trouve envahie de minots complètement défoncés et irrespectueux.
Vous le savez peut-être déjà, Royston Blake est anglais. Plus précisément il est de Mangel. Pour autant, Blake n’est pas un gentleman. Loin s’en faut. Blakey comme l’appelle familièrement les habitants de Mangel est Le Videur de la ville. Celui du Hoppers, pub où se réunit le gratin. Il se plait à se considérer comme un notable, quelqu’un à qui l’on doit le respect. Pour un œil extérieur, Blake apparaît comme une masse de 110 kg de barbaque, de bière et de bêtise. Mais comme c’est lui qui raconte … Or, malgré sa notoriété et sa respectabilité, une fois de plus, le pauvre Blake va foncer tête baissée dans les pires emmerdes quand la ville se trouve envahie de minots complètement défoncés et irrespectueux.  Max Mingus était privé à Miami quand il a abattu les camés qui avaient enlevé, violé et tué une gamine. Il a pris huit ans de prison. Sa peine touche à sa fin quand il est contacté par Allain Carver, un des hommes les plus riches d’Haïti, pour retrouver son fils Charlie disparu depuis maintenant deux ans. Rien dans l’affaire ne plait à Max, mais Allain lui offre une véritable fortune s’il retrouve le gamin, et Max a besoin de faire quelque chose pour oublier la prison, la mort accidentelle de sa femme, et le vide de sa vie. Il accepte donc. Il ne sait pas qu’il va être confronté à une misère bien pire que tout ce qu’il a pu imaginer, à la superstition et à une violence qu’il n’a jamais approchée, même dans les pires quartiers de Miami.
Max Mingus était privé à Miami quand il a abattu les camés qui avaient enlevé, violé et tué une gamine. Il a pris huit ans de prison. Sa peine touche à sa fin quand il est contacté par Allain Carver, un des hommes les plus riches d’Haïti, pour retrouver son fils Charlie disparu depuis maintenant deux ans. Rien dans l’affaire ne plait à Max, mais Allain lui offre une véritable fortune s’il retrouve le gamin, et Max a besoin de faire quelque chose pour oublier la prison, la mort accidentelle de sa femme, et le vide de sa vie. Il accepte donc. Il ne sait pas qu’il va être confronté à une misère bien pire que tout ce qu’il a pu imaginer, à la superstition et à une violence qu’il n’a jamais approchée, même dans les pires quartiers de Miami.