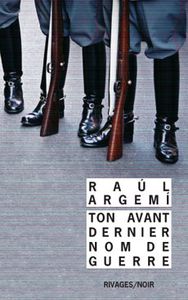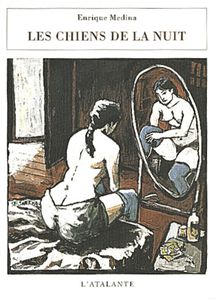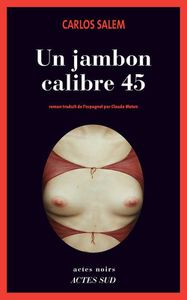Asphalte continue avec bonheur son exploration des nouvelles voix latino-américaines. Bienvenu au Chili de Boris Quercia avec Les rues de Santiago.

Ce matin-là, Santiago Quiñones flic à Santiago du Chili n’a aucune envie de tuer quelqu’un. « Il fait froid, il est six heures vingt-trois du matin, on est tout juste mardi et je n’ai pas envie de tuer qui que ce soit. » Il va pourtant le faire, et c’est un gamin de quinze ans qui va mourir. Pour se remettre, pour oublier, Santiago commence une errance dans les rues de sa ville qui lui fera croiser la belle Ema. Ema qu’il va suivre, sans savoir qu’il met ainsi le pied dans une fourmilière.
Voilà une preuve de plus qu’il n’est pas indispensable d’assommer le lecteur avec des pavés survoltés de 600 pages pour raconter une histoire, faire vivre (et mourir) des personnages et faire partager l’amour pour une ville et ses habitants. En quelques 150 pages ce « petit » roman y arrive très bien.
Alors certes, Quercia ne s’attarde guère sur la procédure policière, ni même sur ce après quoi courent les personnages (appliquant la fameuse théorie du MacGuffin de tonton Alfred). Mais il utilise très bien ce prétexte pour nous entrainer dans les rues de sa ville, et nous faire rencontrer quelques uns de ses habitants. Pas des héros, pas non plus d’abominables salauds, juste des fragments d’humanité, que son flic classe entre gentils et méchants avec des critères assez lâches, très subjectifs mais qui se résument finalement à ceci : ils s’intéressent un peu, ou pas du tout à leurs semblables.
Et finalement, on aurait bien tendance à le suivre et à pardonner bien des entorses à la loi, bien des lâchetés, bien des pas de côté pour un geste, un sourire, un attention. Il résulte de cette démarche une tendresse pour les paumés et un attachement aux habitants de Santiago qui donne envie de partir tout de suite se perdre dans la ville avec Quiñones … ou Boris Quercia.
Boris Quercia / Les rues de Santiago (Santiago Quiñones, tira, 2010), Asphalte (2014), traduit de l’espagnol (Chili) par Baptiste Chardon.