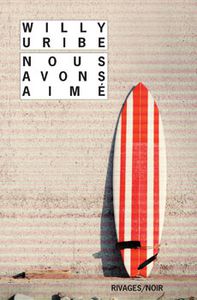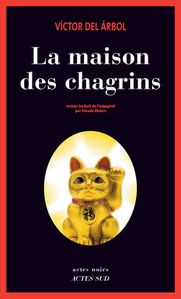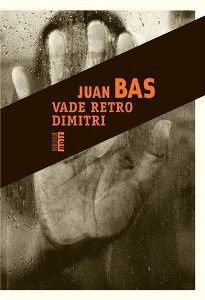J’étais passé complètement à côté du premier roman traduit de Carlos Zanón. Impossible de le terminer, et pourtant j’en avais entendu dire beaucoup de bien. Mais je suis têtu, donc j’ai insisté avec le second N’appelle pas à la maison.

Bruno, Cristian et Raquel vivent d’arnaques minables et squattent à droite et à gauche. Ils gagnent essentiellement de quoi boire et se shooter en faisant chanter les couples illégitimes qu’ils surprennent dans les hôtels des quartiers excentrés de Barcelone.
Merche et Max sont amants. Max est divorcé et travaille dans une boite d’assurances, Merche est toujours avec son mari, artisan. Leur route va croiser celle du trio. Et rien ne va se passer comme prévu.
Cette fois je suis allé au bout, mais je crois qu’il faut que je me fasse une raison, Carlos Zanón c’est surement très bien, mais ce n’est pas mon univers littéraire. C’est simple, je n’arrive pas à m’intéresser aux histoires de ses personnages. Du coup, je trouve que ça traine, ma lecture elle-même trainasse, et même en reconnaissant la qualité de l’écriture et de la peinture d’une Barcelone peu connue, loin des ramblas, des touristes et de la mer, je m’ennuie.
Pourtant elle est bien décrite cette Espagne en pleine crise, où les files aux soupes populaires s’allongent, où les valeurs se diluent dans la misère, financière et culturelle. Pourtant ce sont des thèmes classiques du polar que ceux de l’adultère, de la jalousie et du chantage … Pourtant.
Pourtant, malgré un final fort et très bien maîtrisé qui a réussi à m’accrocher, enfin, rien à faire, je n’arrive pas à m’intéresser à ses tristes histoires d’amour. Ce n’est pas la faute de l’auteur, peut-être la mienne, ou une alchimie qui ne fonctionne pas.
Pour l’avis de quelqu’un qui aime, c’est chez Yan.
Carlos Zanón / N’appelle pas à la maison (No llames a casa, 2012), Asphalte (2014), traduit de l’espagnol par Adrien Bagarry.