Laure devrait être contente. Après une enfance et une adolescence difficiles, elle est amoureuse de Martin, et vient de rentrer, avec lui, dans l'une des plus prestigieuses écoles préparatoires de France. La voie royale (dit-on), vers les plus hautes destinées. Le week-end d'intégration s'est plutôt bien passé, et les autres élèves sont beaucoup moins ennuyeux qu'elle ne le craignait.
Mais le dimanche, en fin d'après-midi, l'enfer commence. Bizutage intensif, violences physiques et surtout psychologiques, humiliation permanente, privation de sommeil et d'intimité … Tout cela au nom de la tradition, et soi-disant pour souder les élèves. Cent fois Laure est sur le point de se rebeller, cent fois elle courbe la tête, se haïssant pour sa lâcheté. Ce qui pourrait n'être "que" traumatisant tourne au drame dès le premier soir. Laure aperçoit, un instant, un corps désarticulé dans la cour. Mais rien, aucune réaction, personne ne dit rien. A-t-elle rêvé ? Est-ce une manipulation de plus ? Ou le bizutage a-t-il vraiment dérapé ce soir là ?
psychologiques, humiliation permanente, privation de sommeil et d'intimité … Tout cela au nom de la tradition, et soi-disant pour souder les élèves. Cent fois Laure est sur le point de se rebeller, cent fois elle courbe la tête, se haïssant pour sa lâcheté. Ce qui pourrait n'être "que" traumatisant tourne au drame dès le premier soir. Laure aperçoit, un instant, un corps désarticulé dans la cour. Mais rien, aucune réaction, personne ne dit rien. A-t-elle rêvé ? Est-ce une manipulation de plus ? Ou le bizutage a-t-il vraiment dérapé ce soir là ?
Malgré une maigre intrigue policière qui vient mettre du piment et du suspense dans ce roman, Je suis morte et je n’ai rien appris de Solenn Colléter n’est pas un polar. L’enquête est anecdotique, et le sujet est ailleurs. Le sujet c'est le bizutage que l’on croyait pourtant disparu.
Au-delà de la description des faits, c’est surtout le démontage des mécanismes qui font que des jeunes gens, a priori sains d'esprits, acceptent de se faire humilier une semaine durant, sans jamais se révolter. Comment cette manipulation, car cela en est bien une, va en faire, quand leur tour viendra, de parfaits bourreaux, qui se seront auto persuadés que, finalement, ils s'étaient bien amusés.
Comment également, des fils et filles de très bonne famille, ainsi que tout leur entourage, qui feraient sans doute un procès retentissant au premier enseignant qui oserait ne serait-ce que lever la main sur eux, ou au premier minot qui oserait les traiter de quelques inoffensifs nom d’oiseaux, acceptent de subir les pires sévices, parce qu'ils sont entre eux, parce c’est la tradition, parce que ces choses là ne doivent pas sortir d’une certain cercle, parce ce serait sans doute trop humiliant que cela se sache, parce que ?
Tout cela est palpable dans le roman, que l'on lit dans un état de stupéfaction permanent. On sent la fatigue, le sentiment de dégoût, de haine pour ce qu’on accepte, l’imbécillité, le sadisme adolescent, l’incompréhension … Avant de se demander, bien entendu, comment on aurait réagi soi-même, à cet âge là.
Parce qu’il est trop facile de se dire qu’à plus de 40 ans (ben oui, c’est triste à dire, mais j’ai plus de 40 ans), le premier qui approche aurait pris un pied, une main, une pala (pour les gens du sud-ouest), ou tout autre ustensile pour les autres, dans la tronche (ou ailleurs). Si on y pense deux fois, on se demande forcément ce qu’on aurait fait à 17 ou 18 ans, quand on est encore fragile, et qu’on a l’impression que si l’on craque, on ne pourra pas rester dans cette école, et que, forcément, on hypothéquera son avenir. Question intéressante, à laquelle il est bien difficile de répondre honnêtement …
Solenn Colléter, Je suis morte et je n’ai rien appris, Albin Michel (2007).
 sont en déroute, avec l’armée républicaine. Ils croisent les derniers vestiges de la guerre. Ils ont froid. Ils ne savent pas encore que la France va les parquer dans des camps de la façon la plus ignominieuse.
sont en déroute, avec l’armée républicaine. Ils croisent les derniers vestiges de la guerre. Ils ont froid. Ils ne savent pas encore que la France va les parquer dans des camps de la façon la plus ignominieuse. 


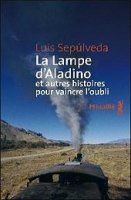 Dans La lampe d’Aladino, on croise un Vieux qui lit des romans d’amour accompagné d’un dentiste qui tentent de sauver ce qui peut l’être d’un pays en guerre ; un pirate portugais révolutionnaire avant l’heure qui patrouille à l’extrême sud du monde ; un commerçant palestinien qui vend des objets de première nécessité et du rêve du côté de Punta Arenas ; des hommes amoureux ; des femmes amoureuses ; des amis qui ses souviennent des chers disparus autour d’une bouteille …
Dans La lampe d’Aladino, on croise un Vieux qui lit des romans d’amour accompagné d’un dentiste qui tentent de sauver ce qui peut l’être d’un pays en guerre ; un pirate portugais révolutionnaire avant l’heure qui patrouille à l’extrême sud du monde ; un commerçant palestinien qui vend des objets de première nécessité et du rêve du côté de Punta Arenas ; des hommes amoureux ; des femmes amoureuses ; des amis qui ses souviennent des chers disparus autour d’une bouteille …  La narratrice est photographe. Elle est en deuil. Depuis 5 ans. Depuis qu'Hugo, son compagnon, s'est suicidé pour ne pas vivre l'agonie d'un cancer. Depuis elle fuit, d'un pays en guerre à un autre, coupant les ponts avec la famille d'Hugo. Aujourd'hui elle est de retour à Versailles, où elle va passer un après-midi avec Nicolas, le frère d'Hugo. Un après-midi pour marcher dans le parc, parler d'Hugo, comprendre la douleur des autres, et, peut-être, retrouver l'envie de vivre.
La narratrice est photographe. Elle est en deuil. Depuis 5 ans. Depuis qu'Hugo, son compagnon, s'est suicidé pour ne pas vivre l'agonie d'un cancer. Depuis elle fuit, d'un pays en guerre à un autre, coupant les ponts avec la famille d'Hugo. Aujourd'hui elle est de retour à Versailles, où elle va passer un après-midi avec Nicolas, le frère d'Hugo. Un après-midi pour marcher dans le parc, parler d'Hugo, comprendre la douleur des autres, et, peut-être, retrouver l'envie de vivre.  psychologiques, humiliation permanente, privation de sommeil et d'intimité … Tout cela au nom de la tradition, et soi-disant pour souder les élèves. Cent fois Laure est sur le point de se rebeller, cent fois elle courbe la tête, se haïssant pour sa lâcheté. Ce qui pourrait n'être "que" traumatisant tourne au drame dès le premier soir. Laure aperçoit, un instant, un corps désarticulé dans la cour. Mais rien, aucune réaction, personne ne dit rien. A-t-elle rêvé ? Est-ce une manipulation de plus ? Ou le bizutage a-t-il vraiment dérapé ce soir là ?
psychologiques, humiliation permanente, privation de sommeil et d'intimité … Tout cela au nom de la tradition, et soi-disant pour souder les élèves. Cent fois Laure est sur le point de se rebeller, cent fois elle courbe la tête, se haïssant pour sa lâcheté. Ce qui pourrait n'être "que" traumatisant tourne au drame dès le premier soir. Laure aperçoit, un instant, un corps désarticulé dans la cour. Mais rien, aucune réaction, personne ne dit rien. A-t-elle rêvé ? Est-ce une manipulation de plus ? Ou le bizutage a-t-il vraiment dérapé ce soir là ?  Ainsi commence le récit de Juan Cabo, quand il sort du coma. Rien d'autre, il a tout oublié. On lui apprend qu'il est un auteur reconnu, et qu'avant d'avoir un accident de la route, il avait dîné dans un restaurant où il avait écrit ces quelques mots. En quête de sa mémoire, il retourne au restaurant, et se renseigne sur la dame qui a pu inspirer une telle phrase. Mais cette femme est-elle réelle, est-elle pure invention ? Son enquête va se révéler à la fois plus réelle et plus littéraire que prévue. Plus dangereuse aussi. Quand au lecteur, il n'a pas fini de se perdre …
Ainsi commence le récit de Juan Cabo, quand il sort du coma. Rien d'autre, il a tout oublié. On lui apprend qu'il est un auteur reconnu, et qu'avant d'avoir un accident de la route, il avait dîné dans un restaurant où il avait écrit ces quelques mots. En quête de sa mémoire, il retourne au restaurant, et se renseigne sur la dame qui a pu inspirer une telle phrase. Mais cette femme est-elle réelle, est-elle pure invention ? Son enquête va se révéler à la fois plus réelle et plus littéraire que prévue. Plus dangereuse aussi. Quand au lecteur, il n'a pas fini de se perdre … Depuis il est homme au foyer, s’occupe de la maison et prépare le repas en attendant sa femme Kumiko. Jusqu’au jour où leur chat, disparaît. A partir de là sa vie déraille. Il reçoit des coups de fils érotiques d’une inconnue, rencontre une voyante coiffée d’un chapeau rouge, fait la connaissance d’une adolescente spécialiste de perruques ... et Kumiko disparaît à son tour, sans laisser de traces. Et ce n’est que le début d’une étrange aventure qui le verra affronter ses cauchemars, et ceux des autres, au fond d’un puits.
Depuis il est homme au foyer, s’occupe de la maison et prépare le repas en attendant sa femme Kumiko. Jusqu’au jour où leur chat, disparaît. A partir de là sa vie déraille. Il reçoit des coups de fils érotiques d’une inconnue, rencontre une voyante coiffée d’un chapeau rouge, fait la connaissance d’une adolescente spécialiste de perruques ... et Kumiko disparaît à son tour, sans laisser de traces. Et ce n’est que le début d’une étrange aventure qui le verra affronter ses cauchemars, et ceux des autres, au fond d’un puits.  sur son lit de mort, avec l’argent qu’il lui a laissé, Eemeli Toropainen crée une fondation et construit une superbe église en bois, quelque part au Nord de la Finlande. La construction est le début d’une aventure qui va voir une bande d’écolos barbus se joindre aux charpentiers, créant le noyau de ce qui va devenir, peu à peu, une communauté autonome, joyeusement bordélique et auto-suffisante. Une communauté qui va grandir et devenir un vrai paradis quand, la crise pétrolière, l’explosion d’une centrale nucléaire russe, puis la troisième guerre mondiale changera le reste du monde en un enfer où sévit la famine …
sur son lit de mort, avec l’argent qu’il lui a laissé, Eemeli Toropainen crée une fondation et construit une superbe église en bois, quelque part au Nord de la Finlande. La construction est le début d’une aventure qui va voir une bande d’écolos barbus se joindre aux charpentiers, créant le noyau de ce qui va devenir, peu à peu, une communauté autonome, joyeusement bordélique et auto-suffisante. Une communauté qui va grandir et devenir un vrai paradis quand, la crise pétrolière, l’explosion d’une centrale nucléaire russe, puis la troisième guerre mondiale changera le reste du monde en un enfer où sévit la famine …  Le jour où Albert Einstein s’est échappé n’est pas un livre gentil, ni consensuel, ce n’est pas non plus un livre parfait. A mon goût, l’auteur s’y laisse trop aller au plaisir de la formule, à la belle phrase, au mot d’esprit. Cela nuit parfois au rythme, et même à la crédibilité. Personne ne peut s’exprimer, penser, tout le temps, comme ça. Même des personnages aussi exceptionnels qu’Einstein, Paula ou Laurent le chauffeur de taxi doivent bien dire, et penser, des choses banales, ou au moins banalement, de temps en temps. Mais cela est très vite oublié, il y a trop d’émotion, d’envie et de plaisir de vivre, de rage salutaire contre la connerie dans ce roman pour qu’on s’arrête à ce détail. On passe de sourire aux larmes, d’une formule qui fait mouche, d’une énergie communicative à une émotion bouleversante, comme il passe du plaisir de déguster enfin un plat qui a le goût de la liberté au souvenir des derniers moments de son ami revenu des camps. Pour tout cela, on est emporté. Et si on peut faire parfois une légère overdose de bons mots, il faut surtout reconnaître que certaines formules valent le détour. Comme celle-ci :
Le jour où Albert Einstein s’est échappé n’est pas un livre gentil, ni consensuel, ce n’est pas non plus un livre parfait. A mon goût, l’auteur s’y laisse trop aller au plaisir de la formule, à la belle phrase, au mot d’esprit. Cela nuit parfois au rythme, et même à la crédibilité. Personne ne peut s’exprimer, penser, tout le temps, comme ça. Même des personnages aussi exceptionnels qu’Einstein, Paula ou Laurent le chauffeur de taxi doivent bien dire, et penser, des choses banales, ou au moins banalement, de temps en temps. Mais cela est très vite oublié, il y a trop d’émotion, d’envie et de plaisir de vivre, de rage salutaire contre la connerie dans ce roman pour qu’on s’arrête à ce détail. On passe de sourire aux larmes, d’une formule qui fait mouche, d’une énergie communicative à une émotion bouleversante, comme il passe du plaisir de déguster enfin un plat qui a le goût de la liberté au souvenir des derniers moments de son ami revenu des camps. Pour tout cela, on est emporté. Et si on peut faire parfois une légère overdose de bons mots, il faut surtout reconnaître que certaines formules valent le détour. Comme celle-ci :  Odell Deefus n’est pas une lumière. Pas complètement idiot non plus, juste un peu lent. Son mètre quatre vingt-dix attire toujours les regards, puis sa lenteur pousse souvent les gens à se moquer de lui. Ce qui peut se révéler une erreur car si Odell est plutôt gentil, il peut aussi être dangereux quand il a acquis la certitude qu’on se moque de lui, ou qu’il est en danger. Il est en route vers le centre de recrutement de Callisto. Maintenant que l’armée américaine manque de volontaires pour aller en Irak, plus besoin d’avoir un diplôme, et il faut bien que quelqu’un aille mettre fin aux agissements de « ces enragés d’islamistes ». Alors pourquoi pas Odell. Malheureusement, sa voiture le lâche à quelques kilomètres du but, et il va demander de l’aide chez Dean Lowry, jeune homme paumé et agressif. Il ne sait pas qu’il n’arrivera jamais au centre de recrutement et qu’une succession invraisemblable d’évènements fera de lui un dangereux terroriste aux yeux de l’opinion et de l’armée américaine.
Odell Deefus n’est pas une lumière. Pas complètement idiot non plus, juste un peu lent. Son mètre quatre vingt-dix attire toujours les regards, puis sa lenteur pousse souvent les gens à se moquer de lui. Ce qui peut se révéler une erreur car si Odell est plutôt gentil, il peut aussi être dangereux quand il a acquis la certitude qu’on se moque de lui, ou qu’il est en danger. Il est en route vers le centre de recrutement de Callisto. Maintenant que l’armée américaine manque de volontaires pour aller en Irak, plus besoin d’avoir un diplôme, et il faut bien que quelqu’un aille mettre fin aux agissements de « ces enragés d’islamistes ». Alors pourquoi pas Odell. Malheureusement, sa voiture le lâche à quelques kilomètres du but, et il va demander de l’aide chez Dean Lowry, jeune homme paumé et agressif. Il ne sait pas qu’il n’arrivera jamais au centre de recrutement et qu’une succession invraisemblable d’évènements fera de lui un dangereux terroriste aux yeux de l’opinion et de l’armée américaine.  Il commence alors à écrire son premier roman, Le seigneur des porcheries (Lord of the Barnyard, 1998), et gagne sa vie en jouant de la musique dans un pub irlandais, et sur le Pont des Arts. C’est là que la fille de Patrick Modiano le rencontre, et, apprenant qu’il écrit, le présente à sa famille qui le prend sous son aile, et le soutient tout au long des dix-huit mois que dure la rédaction de ce premier roman. Il retourne alors aux USA, où il ne trouve pas d’éditeur, quand Patrick Modiano l’appelle : Gallimard accepte de le traduire et de le publier. La publication en anglais ne viendra qu’après. Il vit ensuite à New York, cadre de son second roman. Il se suicide en 2005.
Il commence alors à écrire son premier roman, Le seigneur des porcheries (Lord of the Barnyard, 1998), et gagne sa vie en jouant de la musique dans un pub irlandais, et sur le Pont des Arts. C’est là que la fille de Patrick Modiano le rencontre, et, apprenant qu’il écrit, le présente à sa famille qui le prend sous son aile, et le soutient tout au long des dix-huit mois que dure la rédaction de ce premier roman. Il retourne alors aux USA, où il ne trouve pas d’éditeur, quand Patrick Modiano l’appelle : Gallimard accepte de le traduire et de le publier. La publication en anglais ne viendra qu’après. Il vit ensuite à New York, cadre de son second roman. Il se suicide en 2005.  Evans est violoniste, classique. Le syndicat des musiciens l'envoie à un concert en costume, et à sa grande surprise, lorsqu'il arrive il trouve un public d'abrutis racistes complètement saouls, venus voir un groupe punk allemand particulièrement violent. Circonstance aggravante, Charlie est métis. Il se fait copieusement insulter et menacer, le concert est un cauchemar total. En partant, il jette son violon, abandonne la musique et part dans un hôtel minable, retrouver son ami l'Anarchiste, fainéant fort en gueule, toujours plein de projets totalement irréalisables. Après avoir gagné une petite fortune en allant massacrer des rats dans les égouts, les deux compères prennent une cuite magistrale, et se réveillent dans la chambre d'un hôtel cinq étoiles, en compagnie d'une femme superbe. Les aventures ne font que commencer. Ici aussi, le lecteur éberlué se demande où va l'auteur, pour oublier immédiatement la question, submergé par le maelström. Egolf confirme son talent pour décrire des moments cataclysmiques, où le chaos va crescendo, dévastateur, jusqu'à l'apothéose.
Evans est violoniste, classique. Le syndicat des musiciens l'envoie à un concert en costume, et à sa grande surprise, lorsqu'il arrive il trouve un public d'abrutis racistes complètement saouls, venus voir un groupe punk allemand particulièrement violent. Circonstance aggravante, Charlie est métis. Il se fait copieusement insulter et menacer, le concert est un cauchemar total. En partant, il jette son violon, abandonne la musique et part dans un hôtel minable, retrouver son ami l'Anarchiste, fainéant fort en gueule, toujours plein de projets totalement irréalisables. Après avoir gagné une petite fortune en allant massacrer des rats dans les égouts, les deux compères prennent une cuite magistrale, et se réveillent dans la chambre d'un hôtel cinq étoiles, en compagnie d'une femme superbe. Les aventures ne font que commencer. Ici aussi, le lecteur éberlué se demande où va l'auteur, pour oublier immédiatement la question, submergé par le maelström. Egolf confirme son talent pour décrire des moments cataclysmiques, où le chaos va crescendo, dévastateur, jusqu'à l'apothéose.